SERENDIPITE #5 - mars 2023 - Arrêter de se raconter des histoires
Une longue lettre qui mêle Histoire, féminisme, éducation, langage, philosophie et toutes mes autres marottes...


Sérendipité
7 min ⋅ 07/03/2023

Cette newsletter peut être lue sur la BO suivante
“C’est peut-être juste l’An 40”
Quelles histoires vous racontez-vous? Quelles croyances sont si fermement ancrées en vous qu’en changer provoquerait au mieux une crise ; au pire, un effondrement existentiel ?
Je vous écris cette cinquième lettre à l’aube de mes 40 ans et je préfère vous prévenir, elle sera plus longue que les précédentes.
S’il y a bien une chose que je crois avoir compris, c’est que vieillir c’est arrêter de se raconter des histoires pour écrire sa propre histoire.
Vieillir, c’est choisir de regarder ce qui dans nos histoires n’appartient qu’à nous, ce qui appartient aux autres et se donner la liberté de leur rendre leurs croyances auxquelles nous n’adhérons plus.
Le paradis perdu des certitudes
Arrêter de se raconter des histoires n’a rien de confortable ni d’évident. Sur le chemin nous sommes nombreuses à parfois regretter un paradis perdu, celui des certitudes.
Certitude de l’ordre du monde, de notre place au sein de cet ordre, de la façon dont cette place détermine notre rapport aux autres et le déroulement des jours, des semaines et des années à venir.
Nous avons beau vivre une époque qui nous enjoint de vivre avec l’incertitude en développant notre résilience, nous savons aussi combien cela est difficile, voire impossible. Et ce n’est pas les rayons des librairies ou les plateformes de podcast dégorgeant d’oeuvres censées nous aider à mieux vivre qui nous prouveront le contraire.
L’histoire ou la certitude avec laquelle j’ai personnellement le plus de mal à rompre, c’est celle du progrès. D’un monde assis sur le progrès.
Or, quand le progrès rend le monde progressivement inhabitable, il devient évident que le monde devrait arrêter d’asseoir son histoire dessus.
La définition du progrès que je trouve la plus simple et la plus brillante se trouve dans Alice et le Maire.

J’ai grandi avec l’idée qu’on allait vers le mieux. Que c’était l’ordre des choses, que le monde était toujours allé vers le mieux, grâce à la puissance de l’Homme (oui j’écris Homme parce qu’ici ça compte) et au caractère infini de la croissance. Les Trente Glorieuses avaient bien fait leur oeuvre dans mon éducation.
Je voyais bien quelques grains de sable dans l’engrenage: ce reportage catastrophe d’Envoyé Spécial au moment du sommet de la Terre en 1992, qui m’avait empêché de dormir, ce génocide au Rwanda, ces guerres en Irak ou en Bosnie… Mais bon, comme tous les adultes autour de moi avaient l’air confiants, j’ai fait taire la petite voix qui me disait qu’on allait dans le mur.
J’ai cessé de croire dans le progrès.
Comme beaucoup d’enfants de ma génération, cette évolution ne s’est pas faite en une seule fois.
Cette croyance s’est progressivement effritée entre le 11 septembre 2001 et la victoire de Trump, le 8 novembre 2016, au gré du délitement de nos démocraties, des attentats, des krachs financiers et de l’effondrement climatique.
Plus rien ne tient. Et ça n’ira pas mieux.
Ca ne me rend pas désespérée ou aigrie. Je continue de croire avec Victor Hugo qu’il faut :
“étonner la catastrophe par le peu de peur qu’elle nous fait.”
C’est selon moi la seule façon de transformer la mélancolie d’un monde disparu en une force de vie.
Car c’est de cela dont nous avons besoin. D’une pulsion de vie. Quand tout nous invite à cultiver la pulsion de mort.
Apprendre à bien mourir, c’est apprendre à bien vivre
J’ai lu cette phrase dans le dernier livre de Gabor Maté, The myth of normal (non traduit en français).
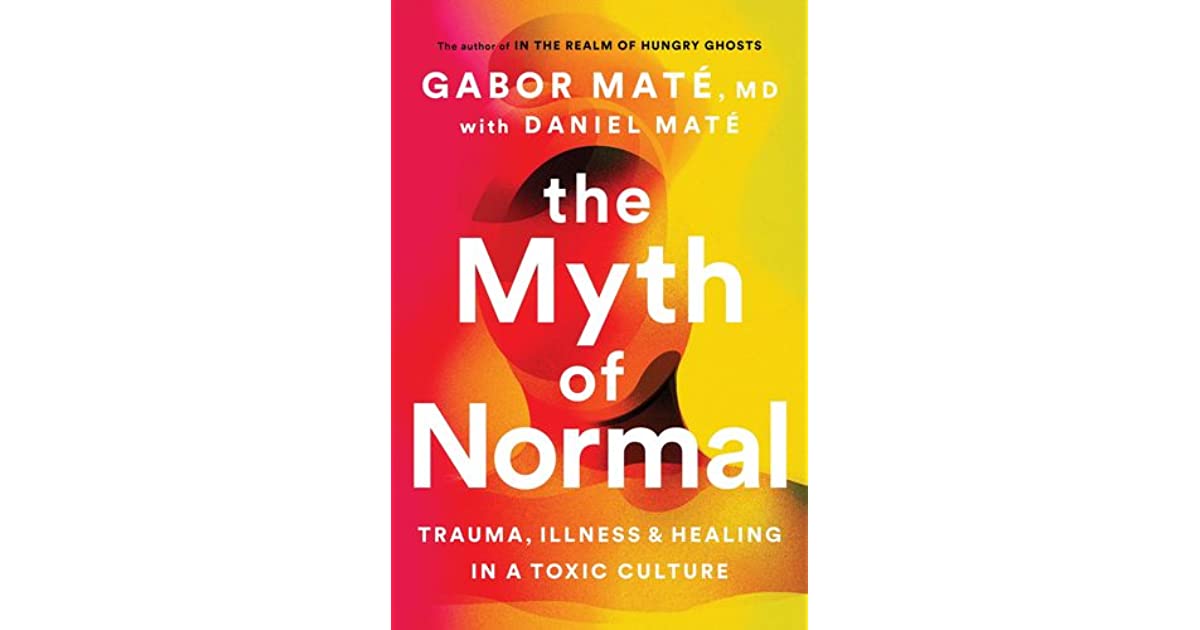
“What we need to die well is what we need to live well. That’s what the disease taught me”
Cette phrase m’a beaucoup parlée parce que je trouve qu’atteindre cette espèce de milieu de vie, de goulot du sablier, c’est quitter réellement l’illusion de l’immortalité pour entrer dans la finitude de la vie. De sa vie.
Face à cela, il n’y a pas quinze réactions possibles selon moi.
Soit vous cherchez à tout prix à ralentir l’écoulement des grains, à boucher le sablier.
Soit vous décidez d’aller avec le mouvement, de faire danser les grains qui tombent sous la lumière qui se diffracte.
Je pense que vous aurez compris quelle option a ma préférence.
En tant que femme blanche d’une société occidentale, je serais pourtant programmée pour ne pas aimer la finitude. Pour ne pas aimer vieillir.
Car vieillir c’est avoir de moins en moins d’histoires à disposition dans lesquelles me retrouver. De moins en moins de corps auxquels m’identifier.
Oui moi aussi j’ai vu passer ces vidéos de Emma Thompson ou Kate Winslet affirmant leur liberté à être sans subir aucune injonction à la beauté. Mais comme elles le font dans un cadre médiatique dans lequel elles sont maquillées et habillées pour l’occasion, je continue de trouver le message dissonant.
Je préfère le travail de Clélia Odette qui photographie de vieilles femmes nues, que je trouve sublimes et qui achève de me convaincre que la finitude des choses peut être très belle, qu’elle peut créer du soin, de la joie, de l’Amour.
Toujours plus d’Amour.
Le monde a peur des vieilles femmes.
Parce qu’une vieille femme qui a compris, accepté et revendique ne plus être bankable sur le marché de la séduction est hors de contrôle. Donc un danger pour le patriarcat.
Dépourvues de toute forme “d’utilité productive”, les vieilles femmes voient s’ouvrir à elles un immense espace de liberté.
Et c’est peut-être ce qui fait que je trouve ça si génial de vieillir.
Je ne donnerais rien au monde pour avoir 15, 20 ou 30 ans à nouveau.
Je n’ai pas le sentiment d’un paradis perdu.
Au contraire, j’assemble laborieusement un puzzle 5000 pièces dont je sais que je ne verrais jamais le bout mais où, à chaque fois que je complète un bout de l’image, tout en moi crie “Eurêka”.
J’en retire une joie profonde parce qu’il n’y a rien de plus satisfaisant selon moi que que la sensation d’avoir allumé une ampoule de plus pour éclairer le chaos qu’est toute vie humaine.
Allumer des lumières pour mettre un peu de clarté dans le désordre
Je crois que c’est à travers ce prisme-là que nous devrions choisir les histoires que nous avons envie de continuer à nous raconter.
Une histoire, ce n’est pas seulement des faits, des personnages, des actions.
Une histoire c’est un univers. Qui convoque des imaginaires. Qui s’appuient sur des croyances. Elles-mêmes fondées sur des valeurs.
Dans les milieux dans lesquels j’évolue, il est très à la mode de parler des “nouveaux imaginaires”, des “nouveaux récits” qu’il nous faudrait inventer pour remplacer les mythologies de la croissance, du progrès et de la domination.
Je ne peux plus voir ces termes en peinture. La plupart de celleux qui portent cette idée ne font au pire qu’en parler et au mieux tentent d’inventer de nouvelles histoires avec les codes narratifs du capitalisme: héros, performance, réussite, mérite...
Si c’est si difficile, c’est qu’il ne s’agit pas juste d’inventer de nouvelles histoires.
Non il faut inventer des histoires auxquelles on puisse croire sans être trompées. Et pour cela, il faut changer les valeurs sur lesquelles nous asseyons nos récits.
Je vous ferais peut-être une newsletter bonus pour vous donner un exemple de ce que je raconte sur la réforme des retraites et la valeur travail.
Changer ses croyances est la forme la plus aboutie de guérison.
C’est la deuxième phrase-clé que je garde de Gabor Maté.
Accepter de regarder ses croyances sur soi, les Autres et le monde avec bienveillance et scepticisme pour décider de celles qu’on garde et de celles qu’on abandonne est un chemin de deuil.
Un chemin sans fin mais comme le dit Orelsan,
“ce qui compte c’est pas l’arrivée c’est la quête.”
C’est aussi ce que disent à peu près toutes les écoles spirituelles, des religions monothéistes aux sagesses venues d’Asie ou d’Afrique en passant par de très nombreuses écoles philosophiques.
Toutes s’accordent à dire que vivre, c’est plutôt faire le GR20 que les 24h du Mans.
Mais l’histoire qu’on nous raconte, c’est qu’on pourrait faire le GR20 à la vitesse d’une Formule 1.
Et recommencer.
Encore et encore.
C’est comme ça qu’on finit épuisée, à se demander ce qui cloche chez nous quand toutes les autres ont l’air de réussir.
Je ne sais pas vous mais “réussir”, c’est l’histoire que je n’ai plus envie que le monde me raconte.
Et que je veux donc arrêter de raconter, de nourrir, d’encourager.
Je ne vous dis pas que je vais y arriver. Que nous allons y arriver. On fait ce qu’on peut.
Et vous, que pouvez-vous changer aux histoires que vous vous racontez?
Bien à vous
Anne
Si vous avez aimé lire cette newsletter, n'hésitez pas à la partager
Si ce texte a fait naître en vous des réflexions que vous avez envie de partager, vous pouvez m'écrire à anne.pedronmoinard@gmail.com
Si vous voulez avoir de mes nouvelles entre deux lettres, je suis sur Instagram et LinkedIn et je tiens une chronique dans le podcast Joie Politique










